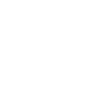L’E-SANTE FAIT DEBAT
 L’E-santé au service des soins dans les îles de la Polynésie française. C’est le thème abordé hier à l’occasion du troisième débat des rencontres numériques en présence de Louis Rolland, Directeur du CHPF, Tuterai Tumahai, Directeur de la Santé, Jean Sarda, médecin inspecteur à la direction de la santé (service information), Patricia Lichon, Directrice de cabinet du Ministre du développement des archipels Louis Frébault, Régis Chang, Directeur de la CPS, Alain Veyret, Directeur de l’Unité de développement IDATE et Moana Tatarata, Président du Conseil d’Administration de la CPS. “Un sujet fondamental qui a des attentes particulières en Polynésie compte tenu de la dispersion du territoire et des complications considérables qu’elle implique” comme l’a rappelé Michel Paoletti (Président des Rencontres Numérique), en introduction de la discussion. La question de fond étant de savoir ce que la mise en place du système d’information à la santé – si elle a bien lieu – va changer pour la totalité des habitants de la Polynésie. Qu’est-ce changera également pour les médecins, infirmiers et institutions hospitalières? “Là où l’avion ne va pas, l’information dématérialisée arrive”, c’est ce qu’a d’abord souligné Alain Veyret. « Certes, il n’y a pas d’aéroports sur tous les archipels mais avec un satellite, on peut avoir autant de point que l’on souhaite. Les bips électroniques peuvent effectivement rendrent ce type de service. Il faut rester très réaliste, on a beaucoup d’exemples qui montrent aujourd’hui qu’avec une bande passante, même extrêmement faible, on sait envoyer des messages numériques qui permettent de faire de la télé expertise, du télédiagnostic à distance. Tant mieux si on les a mais on n’a pas non plus BESOIN d’avoir un réseau de très haut débit, a-t-il modéré”. Le tout est de savoir QUI reçoit l’information et la transmet pour être capable d’établir un diagnostic efficace et permettre ainsi à tous les Polynésiens d’accéder à la médecine de manière équitable. “Il n’y a pas d’infirmiers partout, a remarqué Alain Veyret, ça veut donc dire qu’à un moment donné, pour toucher le citoyen, on va effectivement être amené à se réorganiser. Il faut trouver des gens, qui n’appartiendront pas forcément au corps médical, capables de faire l’intermédiation entre le médecin et le patient : d’amener un acte médical, que ce soit de la téléconsultation, de la télé expertise, de la télésurveillance, ou de la téléassistance, à toute personne, où qu’elle se trouve. L’important est que l’information arrive à bon port, au bon moment”. Il a notamment pris pour exemple la valise satellitaire mise en place en Guyane pour démontrer la réalité de telles méthodes.
L’E-santé au service des soins dans les îles de la Polynésie française. C’est le thème abordé hier à l’occasion du troisième débat des rencontres numériques en présence de Louis Rolland, Directeur du CHPF, Tuterai Tumahai, Directeur de la Santé, Jean Sarda, médecin inspecteur à la direction de la santé (service information), Patricia Lichon, Directrice de cabinet du Ministre du développement des archipels Louis Frébault, Régis Chang, Directeur de la CPS, Alain Veyret, Directeur de l’Unité de développement IDATE et Moana Tatarata, Président du Conseil d’Administration de la CPS. “Un sujet fondamental qui a des attentes particulières en Polynésie compte tenu de la dispersion du territoire et des complications considérables qu’elle implique” comme l’a rappelé Michel Paoletti (Président des Rencontres Numérique), en introduction de la discussion. La question de fond étant de savoir ce que la mise en place du système d’information à la santé – si elle a bien lieu – va changer pour la totalité des habitants de la Polynésie. Qu’est-ce changera également pour les médecins, infirmiers et institutions hospitalières? “Là où l’avion ne va pas, l’information dématérialisée arrive”, c’est ce qu’a d’abord souligné Alain Veyret. « Certes, il n’y a pas d’aéroports sur tous les archipels mais avec un satellite, on peut avoir autant de point que l’on souhaite. Les bips électroniques peuvent effectivement rendrent ce type de service. Il faut rester très réaliste, on a beaucoup d’exemples qui montrent aujourd’hui qu’avec une bande passante, même extrêmement faible, on sait envoyer des messages numériques qui permettent de faire de la télé expertise, du télédiagnostic à distance. Tant mieux si on les a mais on n’a pas non plus BESOIN d’avoir un réseau de très haut débit, a-t-il modéré”. Le tout est de savoir QUI reçoit l’information et la transmet pour être capable d’établir un diagnostic efficace et permettre ainsi à tous les Polynésiens d’accéder à la médecine de manière équitable. “Il n’y a pas d’infirmiers partout, a remarqué Alain Veyret, ça veut donc dire qu’à un moment donné, pour toucher le citoyen, on va effectivement être amené à se réorganiser. Il faut trouver des gens, qui n’appartiendront pas forcément au corps médical, capables de faire l’intermédiation entre le médecin et le patient : d’amener un acte médical, que ce soit de la téléconsultation, de la télé expertise, de la télésurveillance, ou de la téléassistance, à toute personne, où qu’elle se trouve. L’important est que l’information arrive à bon port, au bon moment”. Il a notamment pris pour exemple la valise satellitaire mise en place en Guyane pour démontrer la réalité de telles méthodes.
La mécanique théorique du numérique est en place, a confirmé Tuterai Tumahai, mais ne reste encore qu’à l’état théorique. Dans les îles, elle n’est en pratique qu’aux hôpitaux d’Uturoa et de Taiohae. « Nous avons essayé il y a quelques années de mettre en place des visioconférences entre les hôpitaux périphériques et Mamao et on a quand même été très vite confronté à des problèmes techniques, qui nous ont retardé dans la mise en place du dispositif ». Le dispositif en question, c’est celui du réseau de santé informatisé polynésien (RSIP) et plus particulièrement du dossier médical partagé, amorcé depuis plus de 10 ans, et resté depuis à l’état embryonnaire. Louis Rolland a développé “On est à l’aube de l’exploitation de la télé santé car le câble va constituer une révolution d’ici quelques mois, dans nos pratiques et nos moyens, dans nos dialogues en Polynésie et avec la métropole. Pour le moment on butte à chaque fois sur des problèmes de données et de transmissions”. “Il est clair aussi que lorsqu’on parle d’équipement haut débit pour la santé en Polynésie, on se heurte à des volontés politiques d’équiper un archipel ou une île plutôt qu’une autre en priorité, a concédé Moana Tatarata”. “On ne part pas de 0” a-t-il été observé. Mais Patricia Lichon n’a pas manqué d’insister sur le fait que le câble Honotua, porteur de tant d’espoirs pour la mise en place effective de ce système de santé informatisé, ne va pas aller aux Marquises ni aux Tuamotu. “D’après les informations que nous avons, a-t-elle expliqué, il semblerait que de l’espace satellitaire va être libéré pour permettre la connexion à haut débit entre les grands centres hospitaliers, mais nous n’en avons pas encore la confirmation”. En tant qu’ancien Président du Conseil d’Administration de l’OPT, Moana Tatarata a rassuré à ce propos en assurant que l’Office des Postes avait commandé une centaine de stations satellites portables (VSAT), de manière à équiper un maximum d’atolls ou de zones géographiques éloignées et permettre ainsi l’accès au haut débit à l’ensemble de la population. “D’ici deux ans, il ne restera en Polynésie que cinq îles qui ne disposeront d’aucun moyen de communication, a-t-il précisé”.
Si les bases de la e-santé existent en Polynésie, trop d’éléments sont encore en stand-by pour rendre le concept effectif. Le problème de la culture de partage des informations a été évoqué. Les médecins ont bien souvent du mal à échanger les contenus qu’ils génèrent sur leurs patients, parce qu’ils n’y sont pas habitués. Un élément fondamental qui découle sur un obstacle économique de taille : “En Polynésie, les médecins sont une denrée rare, a constaté Régis Chang. À partir du moment où l’on encombre leurs cabinets avec des patients pour lesquels il faut refaire l’histoire de la maladie car l’échange d’informations ne s’est pas fait, on perd un temps considérable et aussi de l’argent. Pour le moment, on refait 30% des examens du fait que les dossiers médicaux ne sont pas partagés. Avec ce dossier médical partagé, le médecin arriverait rapidement au diagnostic, sans avoir à prendre ni de temps, ni d’argent”. Chacun a avancé dans son coin, a regretté Armel Merceron, venue assister au débat. Il faut arriver maintenant à mettre en place un réseau”. En réponse à la mise en cause de l’instabilité politique et des changements de gouvernement successifs, elle a assuré “L’instabilité, on vit avec. J’espère qu’on en sortira, mais bien des choses ont quand même avancé, même si les ministres ont changé. Je pense qu’il faut aujourd’hui concrétiser cette volonté par une loi de pays qui va peut-être permettre d’avancer et surtout d’arrêter les rivalités qui étaient liées jusque-là aux volontés individuelles d’être leadership”.
La question de la confidentialité et du respect du secret médical n’a pas encore trouvé de réponse, mais le débat a permis de faire la lumière sur le fait que la technique permettait d’ores et déjà de mettre en place le dossier médical informatisé. “Il ne suffit plus que de quelques pas en avant”. Tout est maintenant question de structuration de l’organisation sanitaire. Monsieur Sarda a d’ailleurs annoncé qu’un groupe de travail planchait actuellement sur une réglementation pour mettre en place le dossier informatisé. Reste à espérer qu’elle voit bien le jour d’ici la fin du premier semestre.